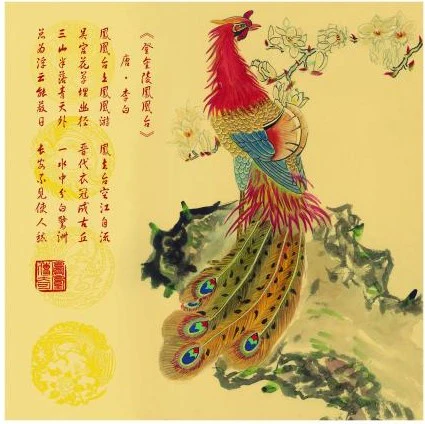Ça y est, nous arrivons dans du terrain plus connu… Mulan, ça vous dit quelque chose ? Qui est-ce qui vient attaquer la Chine dans le dessin animé et dans le film ?
Bon d’abord un mot de Mulan avant d’aller plus loin. La première version de l’histoire de la guerrière Mulan est un chant du nord de la Chine datant du Vème siècle et intitulé La Ballade de Mulan. Ce nord est alors peuplé de nomades non-chinois (Mulan est un nom tabghache, issu d’un peuple turco-mongole venu de Sibérie)… L’intrigue de la ballade est assez similaire à celle reprise par Disney, à ceci près que la famille de Mulan est au courant qu’elle va partir combattre. C’est d’ailleurs son père qui l’entraîne. A la fin de l’histoire, alors qu’elle a avoué sa réelle identité, Mulan ne demande en récompense de ses loyaux services qu’un cheval pour rentrer retrouver les siens. Il ne s’agit ici aucunement d’une épopée patriotique ou féministe : chaque famille doit fournir un(e) combattant(e), qu’il soit homme ou femme. C’est plus un ode à la famille. Par ailleurs, dans ce chant, lorsque Mulan révèle sa véritable identité aux autres soldats, il ne lui est pas reproché de les avoir dupés.
Plusieurs versions de la légende vont en faire petit à petit une icône du patriotisme et puis, au XXème siècle, une icône du féminisme (notamment au moment où les Chinoises luttent contre la tradition des pieds bandés).
Mais revenons en aux envahisseurs : les Huns (peut-être apparentés aux Xiongnu qu’on retrouve dans la littérature chinoise depuis l’Antiquité) car ce sont bien eux qui ouvrent la nouvelles dynasties après avoir envahi le pays (Mulan n’était plus là !).
Plusieurs dates sont donc proposées pour le commencement de la nouvelle dynastie Yuan :
- 1206, année où, avant de partir à la conquête de la Chine, Temüdjin est élu grand khan des Mongols sous le nom de Gengis Khan.
- 1234, année où Ögödei Khan, fils de Gengis Khan, conquiert l’empire Jin qui dirige le nord de la Chine.
- 1260, année du début du règne de Kubilai Khan successeur de son frère Möngke.
- 1276, année de la réunification de la Chine par la reddition de l’impératrice Song dans sa capitale Hangzhou, et date de la remise à Kubilai du Grand Sceau d’empire.
- Certains choisissent également 1279, date de la reddition des derniers Song et de l’achèvement de la conquête de la Chine du sud par Kubilai.
Pour bien s’inscrire dans la tradition chinoise, Kubilai Khan donne un nom à sa dynastie : Yuan, qui vient du livre Yi Jing, un classique chinois, et signifie la Force primaire ou l’origine de l’univers.
La Pax Mongolica qui s’établit alors renforce l’importance des routes de la soie et des contacts avec l’extérieur. Bien sûr, Kubilai étant suzerain des trois autres Khanats (le Khanat de Djaghataï en Asie centrale, la Horde d’or sur les actuelles Russie et Ukraine, et l’Ilkhanat de Perse incluant l’Irak et la plus grande part des actuelles Turquie et Afghanistan), ces échanges sont privilégiés mais c’est aussi la période de la visite de certain vénitien relativement connu : Marco Polo qui reste en Chine de 1275 à 1291.
Pour se plonger dans le début de la période Yuan, je ne peux que vous conseiller la série Marco Polo, qui, de mon humble avis, montre bien le souci du premier empereur mongole d’intégrer la culture chinoise pour justifier et légitimer son pouvoir. Malgré le développement d’inscriptions officielles bilingues (mongole-chinois) et le classement des ethnies avec en premiers les mongoles suivi des hans (et interdit de mariage inter-ethnique), il y a un souci d’acculturation des empereurs mongols (ils veulent devenir chinois).
Lisez ou relisez également la BD Vasco : Les princes de la ville rouge pour vous plonger dans l’univers de cette période.
Kubilai déplace sa capitale de Karakorum (en Mongolie) vers Zhongdu, ancienne capitale du peuple nomade Jurchen et de la dynastie Jin (XIIème siècle), qu’il appelle Khanbalik (Cambaluc dans les récits de Marco Polo) et qui deviendra P3kin. Il place ses palais à l’endroit qui deviendra la Cité interdite (construite seulement à partir de 1406).
Durant la période mongole, la monnaie métallique a un moment été complètement remplacée par de la monnaie papier.
Sous la dynastie mongole, une certaine liberté religieuse prévaut : l’élite mongole est essentiellement bouddhiste mais ils respectent les différentes religions locales et écoutent même les envoyés du Pape comme Guillaume van Rubrouck pour les convertir au christianisme.
Malgré leur désir d’acculturation, les empereurs mongoles ne furent jamais considérés comme réellement chinois et perdirent peu à peu leur pouvoir. D’abord, leur suzeraineté sur les autres khanats s’étiola et puis catastrophes naturelles, sécheresse et famines suivies de la fameuse peste noire (milieu du XIVe siècle) eurent raison de leur dynastie.
En 1351, c’est le début de la rébellion des Turbans rouges, dont une des branches provenait de la Secte du lotus blanc (n’en déplaise à Hergé… Mais là, je fais un anachronisme ! Il s’agit d’un ensemble de sectes bouddhistes plus ou moins unifiées, actives du XIVe au XXe siècle), qui se transforme en soulèvement national. La tradition chinoise prétend que le signal de l’insurrection anti-mongole fut donné le soir de la Fête de la mi-automne par des messages dissimulés dans les gâteaux de lune, consommés par les seuls Hans. Les Turbans rouges prennent Khanbalik en 1368 et le 9ème empereur mongol, Togoontomor, prend la fuite et décède en Mongolie intérieure deux ans plus tard. C’est la fin de la dynastie Yuan.