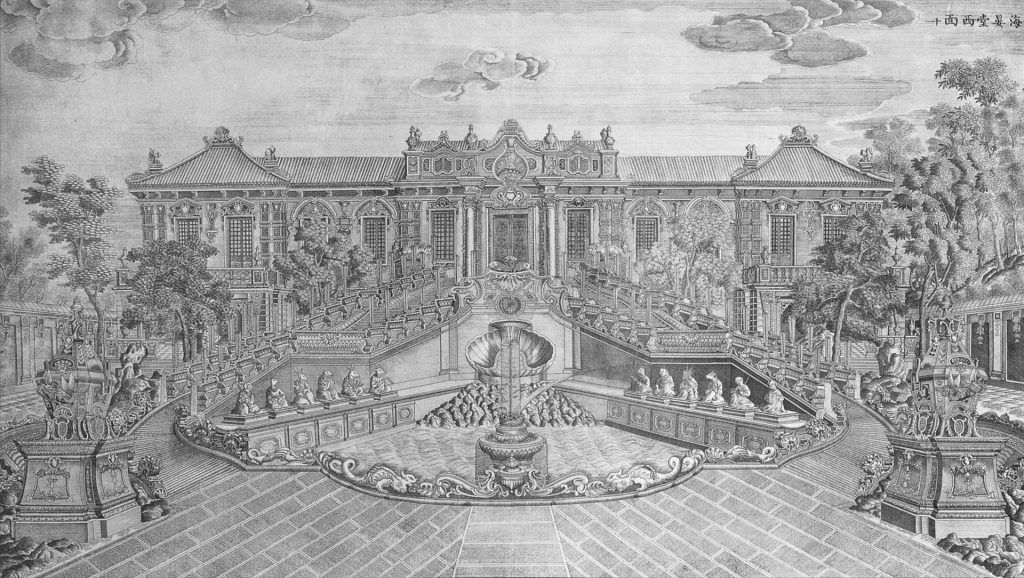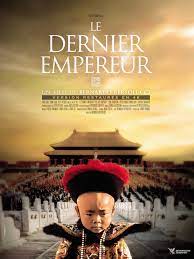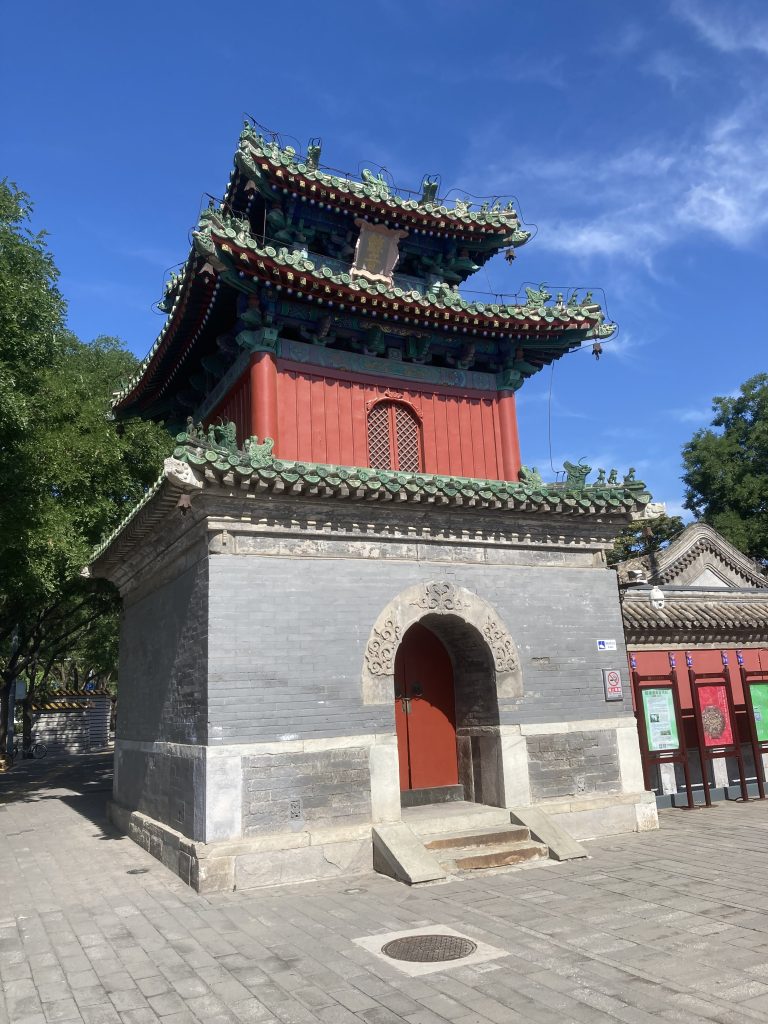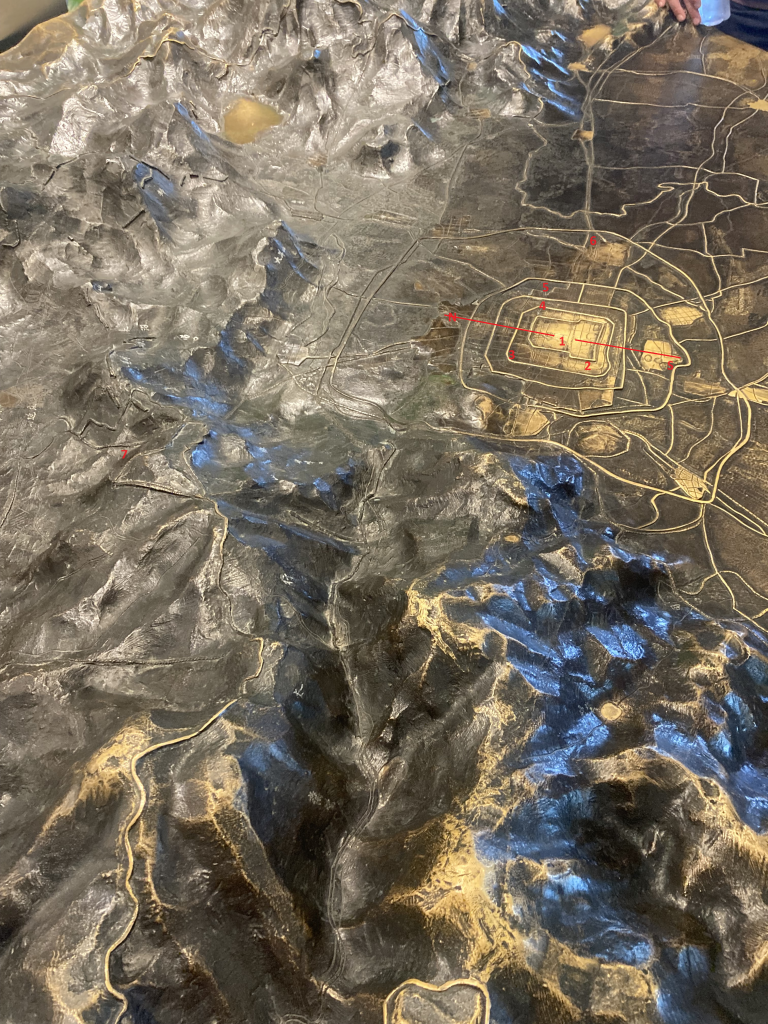Nous venons donc de quitter l’impératrice Cixi et le dernier empereur PuYi en 1911 et la République de Chine est proclamée en 1912 avec Sun Yat-Sen comme premier Président (pour un an) et la parti Kuomintang au pouvoir. L’Empereur n’est pas vraiment démis, il reste symbole du pouvoir, mais cloîtré dans la Cité interdite jusqu’en 1924. On a donc un phénomène assez unique : une république avec un président et un empereur… Puyi sera récupéré plus tard comme empereur de l’Etat fantoche du Mandchoukouo sous la houlette japonaise en 1934 (revoir le film Le dernier empereur).
La nouvelle République sombre très vite dans l’instabilité politique. En 1913, Yuan Shika, chef de l’armée (de Beiyang – d’où le nom de régime de Beiyang repris pour une courte période) « prend » la présidence et tente même de rétablir l’empire à son profit. Son échec, rapidement suivi de son décès, laisse la Chine sans gouvernement central fort.
Des factions rivales commencent à s’empoigner et le pays connaît une période de confusion sous les Seigneurs de la guerre.
La Chine et la Première guerre mondiale
Lorsque le premier conflit mondial éclate, la Chine, embourbée dans cette guerre civile, se déclare neutre, le 6 août 1914. Cette guerre concerne cependant son territoire dans la mesure où des puissances étrangères y possèdent des concessions. Dès le 2 septembre, les Japonais alliés des Français et Anglais s’emparent partiellement des possessions allemandes du Shandong.
De nombreux ouvriers chinois seront recrutés, notamment par la France, durant toute la guerre (plus de 300 000 chinois partiront pour l’Europe).
Le 14 août 1917, la Chine déclare la guerre à l’Allemagne, en prenant le prétexte de la guerre sous-marine à outrance menée par la marine impériale allemande. En échange, les Alliés accordent des facilités économiques à la Chine, tout en maintenant leur emprise (en novembre 1917, les Américains reconnaissent aux Japonais, par l’accord secret Lansing-Ishii, des droits sur la Mandchourie) et les Alliés incluent la Chine dans les dispositions du Traité de Versailles. Mais ces dispositions reconnaissent la mainmise du Japon sur des territoire nationaux (notamment les anciennes colonies allemandes en Chine) ce qui entraînera le mouvement du 4 mai 1919 et la non ratification par la Chine du Traité.
Troubles, guerre civile jusqu’à l’invasion japonaise
Sun Yat-sen rétablit un gouvernement militaire à Canton, mais n’obtient pas de reconnaissance internationale, sauf celle de l’Union soviétique. Sun Yat-sen se fera écarter entre 1919 et 1921 et décède en 1926.
Au sein du Kuomintang, le pouvoir revient de fait à Tchang Kaï-chek, commandant de l’Armée nationale révolutionnaire. Il lance l’expédition du Nord, qui lui permet de soumettre les seigneurs de la guerre et de revendiquer la souveraineté sur l’ensemble de la Chine. Mais entre-temps, le Kuomintang et le Parti communiste chinois (Premier Front Uni)* rompent leur alliance : la guerre civile entre communistes et nationalistes débute dès 1927. Les communistes contrôlent certains territoires, que les nationalistes réduisent militairement au fil des années. Le régime prend à partir de 1928 l’aspect d’une dictature militaire dominée par Tchang Kaï-chek.

En 1934, défaits par les nationalistes et chassés de leurs bases dans les montagnes du sud du pays, les communistes entreprirent la Longue Marche, à travers les régions les plus désolées du pays, vers le Nord-Ouest. Il s’agira d’un périple d’un an d’environ 10 000 li (environ 5000 km) durant laquelle l’armée de 86 000 hommes au départ perd plus de la moitié de ses effectifs mais qui deviendra un épisode important du roman national communiste chinois. Ils établirent leur nouvelle base de guérilla à Yan’an, dans la province du Shaanxi.
- * Le Front Uni est un concept développé par Lénine et repris par le Parti communiste chinois qui soutient, notamment, qu’il faut faire ami-ami avec les partis « proches » pour atteindre les objectifs de la Révolution prolétarienne. Ce concept est encore très présent aujourd’hui comme j’ai pu le signaler à l’occasion.
La seconde guerre mondiale
En 1931, l’empire du Japon envahit et annexe la Mandchourie (suite au sabotage d’une section de voie ferrée japonaise, l’incident de Moukden, voir l’interprétation d’Hergé dans Tintin et le Lotus bleu). En 1937, suite à l’incident du pont Marco Polo (voir ici), il envahit la partie orientale du pays, ouvrant la voie à huit ans de guerre.
Durant cette guerre, le massacre de Nankin (capitale des nationalistes) entre décembre 1937 et janvier 1938, qui fit, selon les estimations, entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers de morts civils (y compris viols et tortures) alors que l’armée nationaliste s’était enfuie face à l’armée impériale japonaise, reste encore aujourd’hui un trauma mémoriel important.
Un second Front Uni est conclus entre le Kuomintang et le parti communiste chinois, dirigé par Mao, contre l’envahisseur. Pendant qu’un gouvernement collaborateur avec les Japonais dirigé par Wang Jingwei revendique à partir de 1940 le nom de République de Chine. Avec l’extension en Asie de la Seconde Guerre mondiale, le régime de Tchang Kaï-chek entre dans le camp des Alliés, rejoint par le parti communiste chinois en juillet 1941.
Après la défaite des Japonais, la République de Chine nationaliste (Kuomintang) tente de stabiliser ses institutions en adoptant une nouvelle constitution, en 1947, mais les troupes communistes de Mao Zedong, armées par l’URSS, prennent l’avantage et repoussent bientôt celles du Kuomintang dans l’ensemble du pays. Mao proclame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 ; en décembre 1949, la classe politique nationaliste et le reste de l’armée de la République de Chine, accompagnés d’un exode de population, s’exilent « provisoirement » sur l’île de Taïwan, reprise aux Japonais en 1945.
Quelques étapes clef de la République populaire de Chine
De 1949 à 1954, on assiste donc à la mise en place d’un régime communiste avec une Constitution promulguée en 1954. Parmi les premières lois adoptées, celle sur le mariage, datée de juin 1950, entend supprimer le modèle patriarcal de la famille, autorise le divorce et établit l’égalité juridique entre hommes et femmes. L’interdiction du bandage des pieds, mesure qui avait été adoptée en 1912, devient réellement effective. La réforme agraire entraîne la répartition de 47 millions d’hectares aux paysans pauvres, mais le terre est divisée en parcelles trop exiguës du fait de la pression démographique.
Un premier plan quinquennal est lancé, qui semble une réussite et encourage Mao Zedong à lancer son Grand Bond en avant en 1958. Il s’agit de se baser sur la paysannerie pour faire avancer le pays dans tous les aspects de son économie. Mais les efforts forcenés dans la sidérurgie par des paysans s’avèrent un désastre. Ce plan est abandonné officiellement en 1962 (officieusement en 1960). Vingt à trente millions de Chinois sont morts de la famine qui s’en est suivie. De 1960 à 1966, la Chine continentale est dans un calme relatif. Le système de production est en convalescence, et reprend peu à peu. En 1966 débute la révolution culturelle. Les étudiants sont mobilisés afin de nettoyer la Chine des « nouveaux capitalistes » et deviennent les gardes rouges de la révolution, défendant les idéaux communistes, et organisant des expéditions punitives partout en Chine, armés notamment du fameux petit livre rouge reprenant des citations de Mao. De nombreuses œuvres anciennes, livres, sculptures, bâtiments, etc. sont détruits. Les intellectuels sont attaqués. La Chine est terrorisée face à l’arbitraire de ces gardes rouges. Fin 1967, l’armée se décide enfin à réprimer le mouvement. L’armée et Mao Zedong en sortent renforcés, avec les gardes rouges, ils ont court-circuité l’appareil de l’État.
La mort de Mao Zedong, le 9 septembre 1976, ouvre la lutte pour la succession. La bande des Quatre (dont la seconde femme de Mao), qui étaient notamment à la base de la révolution culturelle, est arrêtée en octobre. Hua Guofeng mène désormais la Chine avec davantage de pragmatisme, mais c’est surtout l’arrivée de Deng Xiaoping en 1981 qui lance la phase de réformes. Il légitime la quête de biens matériels comme étant une phase transitoire avant le communisme. Il ouvre la Chine aux investissements étrangers, crée des « zones économiques spéciales » et propose l’idée d’« un pays, deux systèmes » (socialiste et capitaliste) comme pouvant parfaitement coexister.
Les événements de la place T. en 1989 forment une espèce de tournant idéologique avec un traumatisme puissant pour l’Etat-Parti et un progressif raffermissement de la pression politique sur le peuple. Suivant les manuels scolaires actuels, rien ne s’est passé en 1989 à P3kin (idem dans le « Wikipedia » chinois, Baidu Baike).
Cette politique est poursuivie globalement jusqu’à l’arrivé de Mr X au pouvoir en 2012 où la vis se resserre fortement et où l’on cherche à revenir à l’idéologie maoïste.